Budget de l’Union européenne : contributeurs et bénéficiaires – Querelles et équilibre collectif
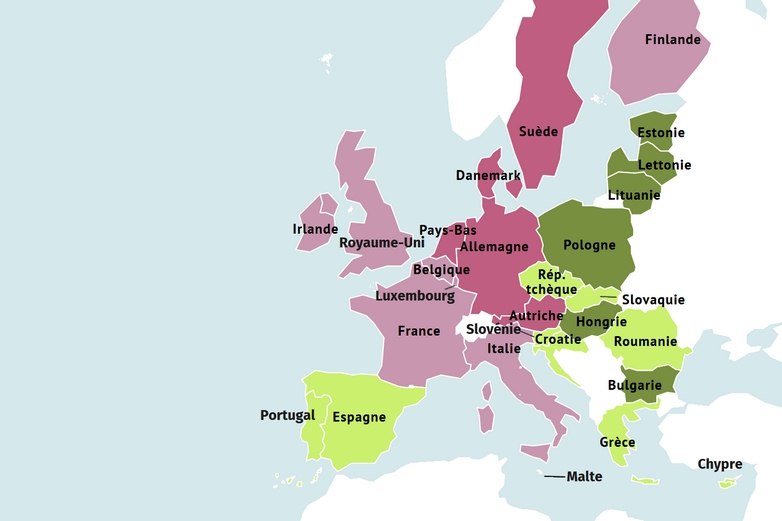
Grain de sel VDB : Malgré de ressources propres ( un % de TVA , les droits de douane, les amendes au titre du droit de la concurrence, etc) , le budget de l’UE est aujourd’hui à 70% des contributions des Etats membres en lien direct avec leur niveau de richesse( mesurée par le RNB). […]
Lire la Suite...





