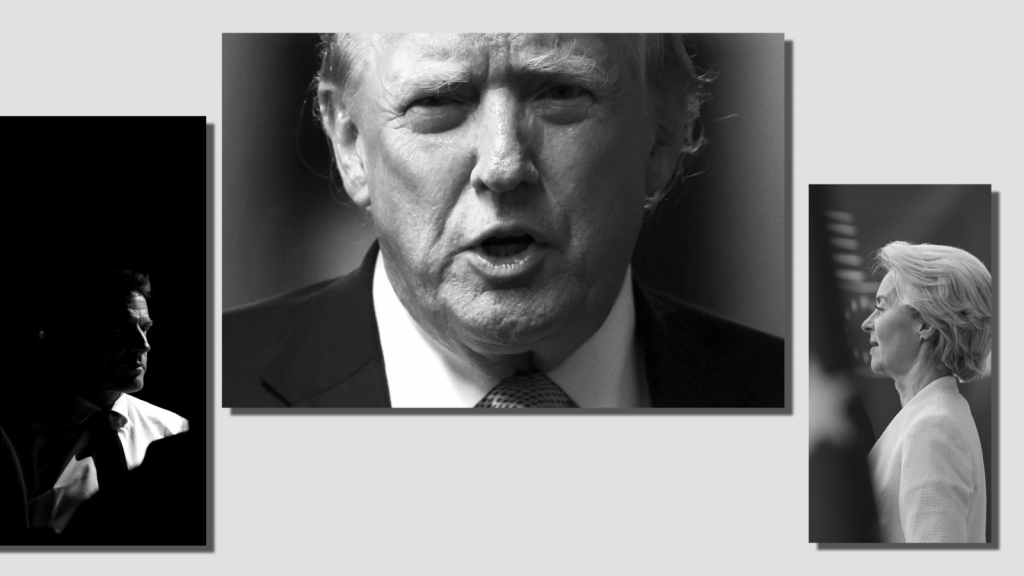
Table of Contents
Grain de sel
Le 13 février dernier, nous publiions un premier article intitulé « US/UE : les dés sont jetés, rien ne va plus face à l’Empire TRUMP« . Nous y analysions le rapport de force économique entre les États-Unis et l’Union européenne à la lumière des menaces tarifaires brandies par Donald Trump. Plus largement, nous évoquions la notion de « vassalisation heureuse », une formule percutante du président italien Mattarella, qui illustre bien la dépendance parfois consentie de l’Europe face à Washington.
Près d’un mois plus tard, la donne a-t-elle changé ? Si les dés semblaient jetés, faut-il aujourd’hui les relancer ? Face à la perspective d’un retour de Trump et à l’intensification des tensions transatlantiques, l’Europe peut-elle – et surtout veut-elle – reprendre l’initiative ?
C’est tout l’enjeu de cette nouvelle réflexion, avancée dans un article du Grand Continent. Une véritable contre-offensive européenne est-elle possible ? Quels leviers mobiliser pour éviter la soumission économique et stratégique ? Autant de questions cruciales à explorer ensemble.
Pour mieux comprendre le point de départ de cette analyse, nous vous invitons à (re)lire notre premier article.
| Breaking News : « America is back »… again ! Trump assume ses visées impérialistes autour du slogan « America first ». Les États-Unis reprennent la main pour mettre fin à la guerre en Ukraine, avec le soutien de Kiev et de Moscou, a déclaré Donald Trump lors d’une session conjointe du Congrès américain mardi soir. Les questions internationales n’ont été mentionnées qu’à la fin de son discours. Donald Trump n’a toutefois pas donné de détails supplémentaires sur les droits de douane à venir sur l’Union européenne. « L’Amérique est de retour » : face au Congrès, Donald Trump conforte sa domination politique – Euractiv FR |
1. La guerre commerciale semble avoir commencé
Un premier bilan impressionnant après seulement quelques semaines de pouvoir
L’Union européenne n’est ni la seule, ni la première région du monde visée par la guerre commerciale de l’administration Trump. Alors que le 47ème président des Etats-Unis a prit le pouvoir il y a quelques semaines seulement, voici un tableau résumant les premières attaques tarifaires américaine vers ses autres partenaires commerciaux, les conséquences et les réactions engagées par ces derniers.
| Région / Pays | Mesures américaines | Conséquences | Réactions / Contre-mesures |
|---|---|---|---|
| Canada | Doublement des tarifs sur l’acier et l’aluminium à 50% ; Menace d’augmenter les tarifs sur les voitures | Augmentation des coûts pour les industries manufacturières et automobiles ; Risque de perturbation des chaînes d’approvisionnement | Tarif de 25% sur l’électricité américaine ; Maintien des tarifs élevés sur les produits laitiers US ; Négociations en cours |
| Mexique | Tarifs de 25% sur les importations, y compris des produits USMCA | Risque de hausse des prix pour les consommateurs américains et mexicains ; Incertitude pour les industries exportatrices | Préparation de mesures de rétorsion ; Tentative de négociation pour retarder l’application des tarifs |
| Chine | Augmentation des tarifs sur toutes les importations chinoises à 20% | Hausse des coûts pour les consommateurs américains ; Risque de ralentissement du commerce bilatéral | Tarifs de rétorsion sur l’agriculture US ; Restrictions sur les entreprises américaines en Chine ; Réduction des exportations de minerais critiques |
| Union européenne | Tarifs potentiels sur l’acier et l’aluminium ; Enquête sur le dumping du cuivre | Impact potentiel sur les industries européennes, notamment automobile et métallurgie | Contre-mesures commerciales possibles ; Pressions diplomatiques pour éviter l’escalade |
| Industrie mondiale du transport maritime | Enquête sur la domination chinoise ; Tarifs et restrictions sur les navires construits en Chine | Perturbations dans la chaîne logistique mondiale ; Hausse des coûts pour les entreprises dépendantes du transport maritime | Renforcement des capacités de construction navale aux États-Unis ; Contestations possibles à l’OMC |
| Secteurs stratégiques (Acier, aluminium, cuivre, semi-conducteurs) | Tarifs de 25% sur de nombreux produits métalliques et industriels | Augmentation des coûts de production aux États-Unis et ailleurs ; Risques pour l’industrie manufacturière | Recherche d’alternatives d’approvisionnement ; Possible ralentissement des investissements étrangers |
2. Les États-Unis sont-ils devenus les ennemis de l’Europe ? 11 perspectives transatlantiques
Auteurs : Rosa Balfour, Timothy Garton Ash, Jean-Marie Guéhenno, Sylvie Kauffmann, Charles A. Kupchan, Nicholas Mulder, Joseph S. Nye, Christine Ockrent, Gideon Rachman, Georges-Henri Soutou, Nathalie Tocci
Nous avons demandé à onze personnalités des deux côtés de l’Atlantique de noter les deux affirmations suivantes de 0 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à fait d’accord) :
Q1 : Avec Donald Trump les États-Unis sont désormais nos adversaires / les adversaires de l’Europe
Q2 : La première question est pertinente
Leurs réponses laissent apparaître un constat clair : la présidence impériale de Donald Trump marque une rupture. Néanmoins, les points de vue divergent quant à la profondeur du fossé qui sépare désormais les deux rives de l’Atlantique et à l’attitude à adopter face à la Maison-Blanche.
Pour soutenir une rédaction indépendante et profiter de l’intégralité de nos contenus tous les jours dans votre boîte mail, abonnez-vous au Grand Continent
Rosa Balfour (Q1) 3/5 | (Q2) 5/5
À tout le moins, il ne fait guère de doute que les États-Unis ne sont plus les amis de l’Europe qu’ils ont été pendant quatre-vingts ans et les alliés sur lesquels on peut compter pour remplir ses engagements envers l’OTAN.
La diplomatie des gangsters visant à faire pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu’il approuve un vague plan de « paix », la répétition des arguments du Kremlin, le vote aux Nations unies aux côtés de la Russie et d’autres États jusqu’à récemment qualifiés d’« États voyous » par le président américain, indépendamment de leur orientation politique, et la récente annonce du retrait du soutien américain à l’Ukraine indiquent que les États-Unis se positionnent comme un adversaire de l’Europe.
Cependant, il convient de faire preuve d’une certaine prudence avant de tirer des conclusions hâtives. Il n’est pas si facile de renverser en quelques jours, voire quelques semaines, quatre-vingts ans de politique étrangère, qui était ancrée dans l’intérêt national des États-Unis, et les relations économiques, sécuritaires et culturelles profondément intégrées. Les institutions, les entreprises et les élites politiques américaines sont attachées à la relation transatlantique et certaines pourraient repousser les instincts de Donald Trump. En effet, un tel revirement pourrait nuire à certains des objectifs supposés de l’administration Trump, tels que la lutte contre la montée en puissance de la Chine sans le soutien ou l’accord de partage des charges avec l’Europe. L’Europe doit se préparer à une confrontation avec les États-Unis tout en gardant la porte ouverte à un éventuel partenariat différent.
Les institutions, les entreprises et les élites politiques américaines sont attachées à la relation transatlantique et certaines pourraient repousser les instincts de Donald Trump.Rosa Balfour
none
Timothy Garton Ash (Q1) 3/5 | (Q2) : 5/5
Il est clair que l’administration Trump est devenue un adversaire de l’Union européenne, et plus largement de l’Europe libérale à laquelle appartiennent également des pays comme le Royaume-Uni, la Norvège et la Suisse.
Mais la moitié des États-Unis et au moins la moitié de l’establishment républicain, ne sont pas d’accord avec Trump — sur l’Ukraine, sur Poutine, sur la nécessité d’alliés européens. Ce n’est qu’au bout de quatre ans que nous verrons si les États-Unis dans leur ensemble sont devenus durablement un pays autoritaire compétitif plutôt qu’un pays démocratique libéral chez eux et une grande puissance nationaliste transactionnelle à l’étranger.
La probabilité reste encore que les Américains redonnent les rênes aux démocrates — avec un d minuscule comme avec un D majuscule — mais beaucoup de dégâts peuvent être causés entre-temps.
Il est clair que l’administration Trump est devenue un adversaire de l’Union européenne, et plus largement de l’Europe libérale. Timothy Garton Ash
Cependant, même dans le scénario le plus optimiste, l’Europe devra assurer sa propre sécurité et défendre ses valeurs et ses intérêts. Quoi qu’il arrive, nous avons besoin d’une Europe plus forte et plus indépendante : en bref, d’une Europe puissance. Cela commence, de toute urgence, par assurer la défense de l’Ukraine tant sur le plan militaire qu’économique — ce qui ne peut se faire qu’en confisquant les actifs russes gelés.
Nous devons élaborer une stratégie pour procéder par étapes, de la défense immédiate à la dissuasion durable pour l’Ukraine, même s’il n’y a pas d’accord de paix officiel entre la Russie et l’Ukraine à court terme. Avec un peu de chance, une Europe plus forte se retrouvera finalement dans un partenariat stratégique plus égalitaire avec des États-Unis post-Trump. Quoi qu’il en soit, ce que j’appelle la période post-Mur, de la chute du Mur de Berlin le 9 novembre 1989 au début de la guerre totale en Ukraine le 24 février 2022, est clairement terminée. Une nouvelle période a commencé, dont le caractère dépendra de ce que nous, Européens, ferons maintenant.
Jean-Marie Guéhenno (Q1) 5/5 | (Q2) 4/5
Trump et Poutine partagent la même vision impériale : ils considèrent que leur sécurité doit reposer sur des rapports de domination. La construction européenne est un obstacle à cette ambition car elle peut les empêcher d’installer leur domination, pays par pays.
Ce différend géopolitique n’est pas une version plus aiguë des tensions entre alliés qui ont émaillé l’histoire des relations transatlantiques. Le différend entre les États-Unis et l’Europe ne porte pas seulement sur le partage du fardeau ou des choix de politique — Viet-Nam, Irak… — il révèle une opposition fondamentale sur les valeurs qui nous rassemblent. D’un côté, une vision du monde qui célèbre le nationalisme, la force et l’autorité du chef, ignore les valeurs de justice, de solidarité et d’humanité, bouscule les institutions, et rejoint les mouvements fascistes des années 1930.
De l’autre, une vision du monde qui rejette le nationalisme destructeur qui a conduit à deux guerres mondiales et valorise le droit et les institutions pour gérer les conflits ; cette opposition est existentielle pour l’Europe non seulement parce qu’elle remet en cause les fondements de sa sécurité — pour la majorité des Européens, la construction européenne n’aurait pas été acceptable sans le lien transatlantique — mais aussi parce que la construction européenne est d’abord une construction juridique qui repose sur la conviction partagée que les rapports entre nations doivent être réglées par le droit.
Trump et Poutine partagent la même vision impériale.Jean-Marie Guéhenno
La question posée est cruciale car la réponse qui lui est donnée doit conduire les européens à réduire le plus rapidement possible leurs liens de dépendance avec les États-Unis, en particulier pour leur sécurité et leurs infrastructures essentielles. Ils doivent se préparer dès maintenant à une aggravation du différend avec les Américains, en particulier sur la politique de sanctions contre la Russie, où ils risquent une collision frontale avec Washington.
Leur situation sera d’autant plus inconfortable que dans leur soutien à l’Ukraine comme dans la dissuasion face à la Russie, ils ne peuvent se substituer du jour au lendemain aux États-Unis, et doivent donc faire semblant de croire que ceux-ci sont toujours leur allié.
Cette hypocrisie nécessaire brouille le message européen. Elle empêche de donner une réponse claire à une autre question cruciale, que le succès même de la construction européenne a progressivement fait oublier : qu’est-ce qui nous distingue des États-Unis ? Si cette question reste sans réponse, le reste du monde verra de plus en plus l’Union comme un grand marché d’abord préoccupé de sa prospérité — indifférente à ce qui ne la concerne pas directement, timide et pâle copie des États-Unis.
Le succès même de la construction européenne a progressivement fait oublier une question cruciale : qu’est-ce qui nous distingue des États-Unis ?Jean-Marie Guéhenno
Sylvie Kauffman (Q1) 4/5 | (Q2) 4/5
Sont-ils désormais des adversaires de l’Europe ? Nous ne savons pas encore si c’est un tournant définitif mais depuis le retour de Donald Trump : oui, ils se comportent en adversaires.
Ils adoptent les positions de notre ennemi numéro un, la Russie ; ils refusent de confirmer la validité de leurs engagements militaires au sein de l’OTAN ; en matière de valeurs, ils contestent le modèle démocratique européen alors que nous étions supposés unis autour du même modèle ; en matière commerciale ils ont un comportement hostile. Cela dit, ils n’ont pas quitté l’Alliance atlantique ni retiré leur dispositif sur le continent européen.
Le monde ne se limite pas aux États-Unis et il faut interroger nos autres partenaires, alliés et non alliés, sur la manière dont ils voient cette rupture.Sylvie Kauffman
La question est pertinente, mais elle ne doit pas être exclusive.
Elle est pertinente car la relation transatlantique structure notre politique extérieure depuis quatre-vingts ans et que la plupart des pays européens ont laissé s’établir une relation de dépendance vis-à-vis des États-Unis pour leur sécurité. Mais le monde ne se limite pas aux États-Unis et il faut interroger nos autres partenaires, alliés et non alliés, sur la manière dont ils voient cette rupture.
Charles Kupchan (Q1) 0/5 | (Q2) 0/5
Non, sous Trump, les États-Unis ne deviennent pas l’adversaire de l’Europe.
À ce stade précoce du second mandat de Trump, il est très incertain de savoir comment ses politiques envers l’Europe évolueront. Un scénario optimiste consisterait dans un partenariat transatlantique continu, avec un rééquilibrage dans lequel l’Europe en fait plus. Un scénario plus sombre impliquerait une érosion de ce partenariat et un retrait stratégique effectif des États-Unis de l’Europe.
La question principale est de savoir si le partenariat transatlantique survivra ou non et, si oui, sous quelle forme.Charles Kupchan
Pour autant, même dans ce second scénario, les États-Unis ne deviennent pas l’ennemi de l’Europe : il n’y aura pas de rivalité militarisée entre les deux côtés de l’Atlantique. Il s’agit simplement de laisser les États-Unis et l’Europe suivre leur propre voie.
C’est ainsi que je formulerais la question — et non en termes de transformation des États-Unis en adversaire de l’Europe. La question principale est de savoir si le partenariat transatlantique survivra ou non et, si oui, sous quelle forme.
Nicholas Mulder (Q1) 3/5 | (Q2) 1/5
Les États-Unis sont une grande puissance qui cherche à maximiser son intérêt national à une époque où son hégémonie mondiale s’affaiblit : tout comme qu’ils n’ont jamais été un allié totalement fiable qui avait à cœur les intérêts de l’Europe, ils ne seront pas non plus un adversaire catégorique.
Les administrations américaines ont longtemps contraint les États européens à se conformer à leurs politiques, notamment en matière de sanctions économiques et de contrôle des exportations. Le fait que cette force soit maintenant utilisée pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne et saper l’UE devrait réveiller l’Europe qui se trouve depuis trop longtemps dans une relation inégale et abusive de dépendance structurelle. Les États-Unis doivent être considérés comme un pays avec lequel l’UE a des intérêts communs importants (commerce, finance et investissement), tandis qu’elle doit poursuivre sans relâche et défendre énergiquement ses propres intérêts (énergie, souveraineté économique et numérique, équité sociale, démocratie) dans d’autres domaines.
Tout comme qu’ils n’ont jamais été un allié totalement fiable qui avait à cœur les intérêts de l’Europe, ils ne seront pas non plus un adversaire catégorique. Nicholas Mulder
La question de l’alliance par opposition à l’antagonisme est trop simple : toutes les alliances sont également des structures qui contraignent autant qu’elles responsabilisent les partenaires. Cette réalité fondamentale de la politique internationale était bien comprise dans la politique européenne des XVIIIe et XIXe siècles, mais a été oubliée par les élites actuelles après des décennies de réflexion passive sur l’OTAN.
L’Europe devrait jouer le même jeu de puissance flexible que les États-Unis, si nécessaire en contrebalançant un rapprochement imminent entre les États-Unis et la Russie par un alignement beaucoup plus étroit entre l’Europe et la Chine. Ce n’est qu’en renforçant nos liens avec les grands États asiatiques — y compris la Chine — que nous pourrons obtenir un meilleur traitement de la part d’une Amérique unilatéraliste et déstabiliser le partenariat opportuniste et superficiel de convenance entre Pékin et Moscou.
À long terme, une Eurasie dans laquelle la Russie et la Chine ne sont pas alignées offrira un environnement stratégique plus prometteur pour l’Europe. Notre objectif devrait donc être de parvenir à un équilibre eurasien sur le continent. Mais il faudra se débarrasser de nombreuses idées préconçues sur les alliances européennes « normales » ; ce n’est qu’en élaborant une nouvelle base réaliste pour la puissance européenne qu’il sera possible de donner force à nos engagements normatifs supérieurs.
Joseph Nye (Q1) 3/5 | (Q2) 4/5
Trump considère l’Europe comme un adversaire.
Trump est un problème, mais il n’est pas l’Amérique. Il a remporté moins de 50 % des voix, et l’atlantisme reste fort chez de nombreux républicains ainsi que chez les démocrates, qui pourraient bien reprendre la Chambre des représentants en 2026. Si la politique sera difficile pour les quatre prochaines années, elle changera lorsque les démocrates reviendront, et la majeure partie de la société civile américaine est pro-européenne.
La question est pertinente, mais le terme « ennemi » n’est pas le bon : si Trump dévalorise l’Europe, la plupart des Américains ne le font pas. La question devrait porter sur l’étendue du chevauchement des intérêts : même avec des divergences, le chevauchement reste important.
Il est difficile de trouver d’autres régions du monde qui partagent davantage leurs valeurs sur le long terme, c’est-à-dire au-delà des quatre prochaines années.
Trump considère l’Europe comme un adversaire. Joseph Nye
Christine Ockrent (Q1) 3/5 | (Q2) 5/5
L’Europe ne peut plus compter sur l’alliance américaine à partir du moment où Donald Trump adhère aux arguments de Vladimir Poutine sur l’Ukraine et vote à l’ONU dans le même camp que la Russie, la Corée du Nord et l’Iran. La séance d’humiliation orchestrée à la Maison-Blanche par le président et le vice-président des États-Unis à l’encontre du président ukrainien en a été la cruelle démonstration.
C’est la bonne question même si on surestime sans doute la dimension stratégique de la « pensée » Trump alors qu’il fonctionne davantage à l’instinct entouré d’une équipe asservie et largement incompétente.
L’Europe ne peut plus compter sur l’alliance américaine à partir du moment où Donald Trump adhère aux arguments de Vladimir Poutine sur l’Ukraine.Christine Ockrent
Gideon Rachman : (Q1) 3/5 | (Q2) 4/5
J’en suis arrivé à la conclusion, à contrecœur, que les États-Unis sous Trump sont désormais un adversaire des démocraties européennes. C’est très difficile à dire, car j’ai été très pro-américain toute ma vie et que j’aime et admire ce pays.
Mais la vieille Amérique a vécu — du moins pour l’instant.
Il est clair que les États-Unis ne sont plus un allié fiable, étant donné l’engagement incertain de Trump envers l’OTAN, ses droits de douane et les menaces et insultes qu’il a proférées à l’encontre d’alliés traditionnels tels que le Canada et le Danemark.
Il y a certes une différence entre ne pas être un allié fiable et être un adversaire, mais je pense que Trump a commencé à franchir cette ligne. Ses ambitions pour le Groenland menacent le territoire d’un allié de l’OTAN. Il est clairement plus favorable à Poutine qu’à Zelensky, ce qui met en danger la sécurité européenne. Et en s’alliant à l’extrême droite européenne, en particulier à l’AfD en Allemagne, il a clairement montré que son administration souhaite porter l’extrême droite au pouvoir dans toute l’Europe. C’est une menace pour la démocratie européenne. Pour l’instant, oui, les États-Unis agissent comme un adversaire de l’Europe.
J’en suis arrivé à la conclusion, à contrecœur, que les États-Unis sous Trump sont désormais un adversaire des démocraties européennes.Gideon Rachman
Georges-Henri Soutou : (Q1) 3/5 | (Q2) 0/5
Les États-Unis nous lâchent soudain et dans la guerre d’Ukraine — dans le déclenchement de laquelle ils ont une part de responsabilité — et dans le développement idéologico-sociétal que certains appellent « wokisme », parti de Californie dans les années 1960 et diffusé dans le monde sous la pression des agences et des fondations américaines, et que maintenant ils nous reprochent !
Mais ce n’est pas la première fois : en 1919, après avoir imposé la SDN et une vision démocratico-libérale du monde, dès l’automne, en refusant de ratifier le Traité, le Sénat met tout l’édifice par terre et contribue ainsi de façon non négligeable aux problèmes des années 20 et 30.
On pourrait donner d’autres exemples. Depuis le début, les États-Unis balancent entre un unilatéralisme politique et idéologique et un multilatéralisme impérial.
La question n’est pas bien posée, car c’est aux Européens de ne pas se laisser aller aux modes d’Outre-Atlantique et de ne pas courir partout comme des poules décapitées quand Washington ne tient pas compte d’eux. Et ce quelle que soit la qualité de leurs relations, avec leurs hauts et leurs bas.
Depuis le début, les États-Unis balancent entre un unilatéralisme politique et idéologique et un multilatéralisme impérial.Georges-Henri Soutou
Et le balancier reviendra : un jour ils ne se désintéresseront à nouveau plus de nous. Et, probablement, certains s’en plaindront !
Nathalie Tocci : (Q1) 5/5 | (Q2) 5/5
Les États-Unis de Trump ont l’intention de diviser les Européens, d’affaiblir la démocratie européenne, de détruire l’intégration européenne et peut-être aussi l’OTAN. Dans la mesure où je considère la démocratie libérale et l’intégration européenne comme essentielles à la paix et à la sécurité sur le continent, il est difficile de ne pas voir les États-Unis de Trump comme un adversaire qui peut représenter une menace existentielle.
La question est pertinente car les États-Unis ont les moyens d’exercer une influence sur l’Europe, dont le système immunitaire vis-à-vis de Washington est très faible.
Les États-Unis ont les moyens d’exercer une influence sur l’Europe, dont le système immunitaire vis-à-vis de Washington est très faible. Nathalie Tocci
Après avoir été habitués à considérer les États-Unis comme un allié pendant quatre-vingts ans, sauter le pas psychologique pour les considérer comme un adversaire est une chose que les Européens refuseront de faire jusqu’au tout dernier moment — et peut-être même au-delà.
A lire aussi : L’Europe dans un étau – Tribune de B. Le Maire
3. Les attaques économiques de l’administration Trump
En matière de contrôle des IDE « America first » by Trump : le rôle du CFIUs dans la nouvelle doctrine
Dans un contexte de tensions économiques et géopolitiques croissantes, la Maison-Blanche a publié un mémorandum définissant une nouvelle politique d’investissement. En cohérence avec sa doctrine « America First », Trump place la sécurité nationale au cœur des décisions en matière d’investissements directs étrangers (IDE). Contrôle accru des investissements étrangers, traitement préférentiel pour les alliés, durcissement réglementaire et fiscal, etc., cette politique vise à renforcer l’attractivité des États-Unis pour les capitaux alliés tout en limitant l’accès à certains secteurs stratégiques pour les investisseurs issus de pays adversaires, notamment la Chine.
Le Comité sur l’investissement étranger aux États-Unis (CFIUS) joue un rôle central dans la mise en œuvre de cette nouvelle doctrine. Ce mécanisme interagences, déjà chargé d’examiner les transactions susceptibles d’affecter la sécurité nationale, voit son champ d’action élargi. Désormais, le CFIUS doit s’assurer que les investissements en provenance de la Chine et d’autres « adversaires étrangers » ne compromettent pas l’accès aux technologies sensibles, aux infrastructures critiques et aux données personnelles des citoyens américains.
Le mémorandum présidentiel insiste sur le fait que « la sécurité économique est une question de sécurité nationale ». Il souligne notamment que la Chine utilise diverses stratégies, directes et indirectes, pour acquérir des technologies de pointe et renforcer son complexe militaro-industriel. Pour contrer cette menace, l’administration Trump a renforcé les pouvoirs du CFIUS, lui permettant de bloquer ou de restreindre plus efficacement les transactions impliquant des entreprises chinoises, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs et de la biotechnologie.
Parallèlement à ces restrictions, la politique « America First » introduit un processus d’examen « fast-track » destiné à faciliter les investissements en provenance de pays alliés. Cette mesure vise à encourager les capitaux issus d’Europe, du Japon ou encore d’autres partenaires stratégiques à investir aux États-Unis, notamment dans les technologies de pointe.
Cette approche différenciée reflète une stratégie plus large : renforcer l’indépendance économique américaine tout en consolidant un bloc d’alliés économiques face à la Chine. En outre, l’administration prévoit de réduire la dépendance aux capitaux chinois en limitant les investissements américains dans les entreprises chinoises impliquées dans le programme de fusion militaire-civile de Beijing.
En plus des restrictions imposées par le CFIUS, le mémorandum prévoit d’autres mesures visant à freiner l’influence économique chinoise. Parmi elles, une révision du traité fiscal américano-chinois de 1984 est envisagée, ainsi qu’un examen des pratiques comptables des entreprises chinoises cotées aux États-Unis. Ces actions visent à restreindre l’accès des entreprises chinoises aux capitaux américains et à encourager les investisseurs à privilégier les entreprises nationales.
Enfin, l’administration Trump prévoit d’interdire aux fonds de pension et aux universités américaines d’investir dans des entreprises chinoises liées au complexe militaro-industriel de Beijing. Cette mesure s’inscrit dans une volonté plus large de limiter le financement indirect de l’effort technologique et militaire chinois par les investisseurs américains.
La doctrine « America First » en matière de contrôle des IDE marque un tournant majeur dans la politique d’investissement des États-Unis. En renforçant le rôle du CFIUS, l’administration Trump cherche à protéger les actifs stratégiques américains tout en favorisant les investissements des alliés. Cette politique reflète une prise de conscience accrue des enjeux de sécurité économique et technologique, mais pose également des questions sur son impact à long terme sur l’attractivité des États-Unis pour les investisseurs étrangers.
Pour aller plus loin : voici le mémo complet.
A lire aussi : The America First « choose your own tariff » adventure
4. Comment l’Europe peut faire plier Trump: notes stratégiques pour organiser la résistance
| Breaking News : L’UE riposte avec des contre-mesures contre les tarifs « injustifiés » de Trump La Commission européenne a annoncé ce matin l’adoption de contre-mesures sur les importations américaines dans l’UE en réponse à l’imposition de nouveaux tarifs américains « injustifiés » et « nuisibles » sur les importations d’acier et d’aluminium européens. Au total, ces contre-mesures européennes pourraient s’appliquer aux exportations américaines pour une valeur pouvant atteindre 26 milliards d’euros, reflétant l’ampleur économique des tarifs américains. La riposte de l’UE suivra une approche en deux étapes : Expiration des contre-mesures existantes : La suspension des contre-mesures de 2018 et 2020 contre les États-Unis expirera le 1er avril. Ces mesures ciblaient une gamme de produits américains en réponse aux dommages économiques subis par 8 milliards d’euros d’exportations européennes d’acier et d’aluminium. Nouvelles contre-mesures : En réaction aux derniers tarifs américains, qui affectent plus de 18 milliards d’euros d’exportations européennes, la Commission introduit un nouveau paquet de contre-mesures visant des produits américains. Ces mesures entreront en vigueur d’ici la mi-avril, après consultation des États membres et des parties prenantes. « L’Union européenne doit agir pour protéger les consommateurs et les entreprises. Les contre-mesures que nous adoptons aujourd’hui sont fortes mais proportionnées », a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans un communiqué. « Depuis ce matin, les États-Unis appliquent un tarif de 25 % sur les importations d’acier et d’aluminium. Nous regrettons profondément cette mesure. Les tarifs sont des taxes. Ils sont mauvais pour les entreprises et encore pires pour les consommateurs. Ces tarifs perturbent les chaînes d’approvisionnement, ils créent de l’incertitude pour l’économie. Des emplois sont en jeu. Les prix vont augmenter. En Europe comme aux États-Unis », a ajouté von der Leyen. « Nous resterons toujours ouverts à la négociation. Nous sommes convaincus que dans un monde marqué par des incertitudes géopolitiques et économiques, il n’est pas dans notre intérêt commun d’alourdir nos économies avec des tarifs. Nous sommes prêts à engager un dialogue constructif. » Le processus lancé par la Commission en représailles aux nouveaux droits de douane américains s’inscrira dans le cadre du règlement de l’UE sur le respect des règles du commerce international, la mesure américaine étant en effet considérée comme une mesure de sauvegarde. Première étape de ce processus, une consultation des parties intéressées sera menée pendant deux semaines, soit jusqu’au 26 mars. Sur la base des contributions recueillies, la Commission finalisera sa proposition d’adoption de contre-mesures et consultera les États membres selon la procédure dite de comitologie. Une fois ce processus clôturé, la Commission devrait mettre en place l’acte juridique imposant les contre-mesures pour la mi-avril. La Commission affirme que l’UE reste disposée à collaborer avec l’administration américaine pour trouver une solution négociée. Les mesures mentionnées ci-dessus pourront être annulées à tout moment si un tel accord est trouvé. |
Après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l’Europe fait face à une crise existentielle. Les initiatives du président américain et le changement d’ère symbolisé par le discours de J. D. Vance à la conférence sur la sécurité de Munich obligent à un sursaut collectif — pour l’Ukraine, pour l’architecture de sécurité européenne, mais également, et c’est l’objet de cet article, pour ses relations économiques. Car le risque est en effet grand que les offensives américaines en la matière ne conduisent, dans les prochains mois, à un « Munich économique » : une capitulation en ordre dispersé devant les États-Unis qui assurerait à la fois le déshonneur et la défaite.
Pour cela, il convient cependant de regarder lucidement nos vulnérabilités. Stratégiquement, l’Europe a longtemps adossé son architecture de sécurité et de défense sur les Américains, ce qui donne aux États-Unis un levier considérable. Les menaces de Donald Trump concernant le financement de l’OTAN, la perspective d’un accord de paix avec la Russie signé sur le dos de l’Ukraine ou encore son intérêt pour le Groenland n’ont suscité que de trop rares réactions de la part des institutions européennes et des dirigeants nationaux, avant les réunions d’urgence organisées à Paris, Washington et Londres par Emmanuel Macron et Keir Starmer. Économiquement, l’Europe a une carte à jouer, mais elle a trop souvent peur de sa propre force, restant le dernier défenseur impuissant d’un ordre commercial international libéral en pleine désagrégation. Elle doit enfin accepter de mener une politique économique plus offensive, pour ne pas être broyée par la tenaille sino-américaine. Cet examen de conscience va plus loin que de simples considérations de politiques publiques. Idéologiquement, la transformation du paradigme dominant des relations internationales, passé du libre-échange néolibéral au mercantilisme et d’un « ordre international multilatéral ouvert fondé sur des règles » à un monde fondé sur l’usage de la force, du primat de l’économie à celui de la géopolitique, plonge l’Europe dans la tétanie.
Le sursaut est toutefois possible, car les Européens prennent progressivement conscience de la nécessité d’une révolution culturelle. La possibilité de tarifs généralisés de l’ordre de 25 % sur tous les biens européens dès le mois d’avril rend la réaction européenne urgente. Le thème de la « souveraineté » européenne progresse et le langage de la puissance effraie de moins en moins. Par ailleurs, le rapport Draghi a permis un début d’aggiornamento économique européen sur la politique économique intérieure. La « Boussole sur la compétitivité » présentée mi-janvier par la présidente de la Commission européenne a pour but de le mettre en œuvre, mais il faudra un grand nombre d’initiatives législatives dans les mois à venir pour être à la hauteur.
Les Européens prennent progressivement conscience de la nécessité d’une révolution culturelle.David Amiel et Shahin Vallée
En outre, et c’est le cœur de notre propos ici, le rapport Draghi doit être complété par un aggiornamento sur la politique économique extérieure. L’Union, si elle le souhaite, peut bâtir un véritable « protectionnisme de dissuasion », c’est-à-dire un arsenal de mesures capables de riposter de manière crédible, durable et efficace à une offensive économique américaine qui s’annonce bien plus large que les initiatives tarifaires prises lors du premier mandat de Donald Trump : il faudra donc être capable de déclencher des frappes économiques dans la profondeur contre des intérêts américains, au-delà de « simples » ripostes tarifaires.
Cette première étape, indispensable, doit permettre d’en ouvrir une seconde, où l’Europe reprendrait enfin la main, ce qui requiert des changements profonds dans la politique commerciale, industrielle, fiscale mais aussi dans la politique macroéconomique du continent. C’est à ce prix qu’elle peut être capable de lancer une contre-offensive face aux initiatives américaines, qui dépasseront elles aussi le terrain commercial, en relançant immédiatement l’investissement intérieur, en nouant une alliance « de revers » avec les économies émergentes tout comme en ouvrant la voie, sans doute à moyen terme, à un nouvel accord du Plaza avec les États-Unis et la Chine. En défendant ses intérêts, l’Europe ouvrira aussi la voie à une feuille de route de réforme de la mondialisation, qui, sans céder au trumpisme, prendrait acte des faillites du modèle actuel, et tenterait d’avancer vers un nouvel ordre international qui donnerait toute sa place aux grandes économies émergentes en lieu et place de feu le « consensus de Washington ».
[Tendances clefs, données, analyses: découvrez notre Observatoire de la guerre commerciale de Trump]
Pour un « protectionnisme de dissuasion » capable de frapper en profondeur
L’Europe ne peut plus se contenter d’une réponse tarifaire classique et ciblée, aussi nécessaire soit-elle, sur le marché des biens pour faire face au protectionnisme américain. L’approche adoptée en 2017-2018 par la Commissaire au Commerce extérieur, Cecilia Malmström, et la Commission Juncker 1, dit « Plan Juncker » qui consistait à appliquer des contre-mesures douanières ciblées (voir Tableau 1) et négocier un accord d’achats (de biens agricoles ou de gaz), ne serait aujourd’hui ni efficace ni soutenable.
L’approche de Trump I était relativement ciblée en concentrant son attention sur l’acier et l’aluminium et sur le secteur automobile. L’approche de Trump II semble bien plus généralisée. Il a été évoqué pendant la campagne des tarifs douaniers sur tous les biens de 10 % et plus récemment, une élévation de tous les tarifs douaniers américains au niveau des tarifs douaniers réciproques. S’il prend en compte la TVA comme une barrière non tarifaire comme il le suggère, cela pourrait impliquer des tarifs douaniers massifs contre l’Union. Nous devons donc élargir considérablement notre arsenal car la riposte commerciale devra être complétée par d’autres.
En outre, les offensives américaines elles-mêmes ne se limitent pas aux droits de douane (voir Tableau 1) mais visent à contraindre l’Union européenne à modifier ses politiques économiques, dans un sens favorable aux intérêts américains, notamment dans le domaine numérique. Les menaces contre le DSA et le DMA sont claires et doivent nous pousser à utiliser ces instruments de manière plus offensive même s’ils n’ont pas été conçus comme des outils politiques. Dès les premiers jours de la présidence de Donald Trump, le mémorandum America First Trade Policy annonçait une refonte globale des outils de protection économique. Il prévoyait notamment un examen approfondi de la base industrielle et manufacturière des États-Unis, ainsi qu’un durcissement des contrôles à l’exportation visant à préserver l’avance technologique américaine dans des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle ou les semi-conducteurs 2.
Il est urgent que la Commission européenne identifie l’ensemble des exportations de biens et de services américains qui pourraient faire l’objet d’une riposte massive.David Amiel et Shahin Vallée
Par ailleurs, il est notable que cette offensive précède même l’entrée en fonction de l’administration Trump : l’administration Biden avait pris, dans ses derniers décrets présidentiels notamment le 13 janvier 2025 3, des mesures fortes de restrictions des exports de puces et semi-conducteurs à certains pays de l’Union, ouvrant potentiellement des questions importantes pour l’intégrité du marché unique, de la politique commerciale européenne.
Il est donc urgent que la Commission européenne identifie l’ensemble des exportations de biens et de services américains qui pourraient faire l’objet d’une riposte massive. Cette liste devrait être construite afin de maximiser les dommages infligés, et être autant que possible mise en œuvre quels que soient les biens européens visés par les Américains, tout en prévoyant des mesures spécifiques d’accompagnement de soutien à ces filières, afin de ne pas laisser s’installer des tensions entre États membres et des négociations bilatérales entre eux et les États-Unis.
Par ailleurs, l’Europe doit renforcer ses propres instruments de défense économique. Comme l’Union est un exportateur de premier plan dans un contexte de croissance faible, une guerre commerciale symétrique affaiblira nécessairement davantage ses industries, sans garantir un rapport de force favorable face aux États-Unis. Comme le montre la récente opposition de cinq pays, dont l’Allemagne, à l’introduction de droits de douane européens sur les véhicules électriques chinois en octobre dernier, les tensions entre la nécessité de défendre les industries européennes et la protection des intérêts économiques à court terme de certains États peuvent empêcher l’émergence d’une ligne stratégique claire dans la durée.
Face à ces défis, l’Union doit repenser son arsenal de rétorsion et adopter une stratégie plus large, combinant politique commerciale, politique de concurrence, soutien à l’innovation et protection des secteurs stratégiques. Il ne s’agit pas de céder à un protectionnisme aveugle, mais bien d’instaurer un « protectionnisme de dissuasion », envoyant un signal clair aux États-Unis en étant capable de lancer des frappes économiques dans la profondeur.
Un premier levier réside dans la politique financière, notamment à travers la réglementation et la supervision du secteur. L’Union pourrait restreindre l’accès des entreprises financières américaines au marché des services financiers européens en durcissant les exigences réglementaires, et l’accès au marché européen des entreprises américaines, notamment les licences bancaires ou de manière plus subtile par les mesures dites du « second pilier » de supervision. Cela pourrait également contraindre l’accès des gérants américains à l’épargne européenne via une modification de la directive AIFMD. L’Union pourrait également utiliser son mécanisme de screening des investissements étrangers pour limiter les accès américains aux entreprises/actifs européens si nécessaire. Cette approche permettrait de mieux protéger les intérêts européens face à des acteurs américains dominants tout en garantissant des règles du jeu plus équitables.
Il ne s’agit pas de céder à un protectionnisme aveugle, mais d’instaurer un « protectionnisme de dissuasion », envoyant un signal clair aux États-Unis en étant capable de lancer des frappes économiques dans la profondeur.David Amiel et Shahin Vallée
L’accès au marché numérique constitue également un point clé, particulièrement dans un contexte où les grandes entreprises technologiques américaines, les GAFAM, cherchent à se soustraire aux obligations européennes en matière de surveillance des contenus et d’égalité de traitement politique. L’Union dispose déjà d’instruments puissants, tels que le Digital Markets Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA), qui imposent des obligations strictes aux plateformes dominantes. Renforcer leur application 4 et durcir les sanctions en cas de non-respect offrirait à l’Europe un moyen de pression supplémentaire pour défendre ses intérêts numériques et éviter que des entreprises américaines ne dictent unilatéralement leurs conditions sur le marché européen même si la simple mise en œuvre du droit européen actuel semble remise en cause par la nouvelle administration américaine. Une confrontation dans le domaine du numérique semble de plus en plus inévitable.
Un autre axe de riposte repose sur la politique de concurrence. L’Union pourrait renforcer sa surveillance des abus de position dominante et du contrôle des concentrations, afin d’éviter que des entreprises américaines n’acquièrent une influence excessive sur les marchés européens. Par le passé, la Commission européenne a déjà utilisé ces instruments, notamment en infligeant de lourdes amendes à Google, Apple, Microsoft pour pratiques anticoncurrentielles. Il est possible d’envisager également des mesures comportementales pouvant aller jusqu’à la cession de certains actifs. C’était le sens de la première affaire Microsoft il y a plusieurs décennies et c’est actuellement ce qui est débattu dans les affaires pendantes devant le juge américain concernant Google 5 — ce serait en réalité un retour aux origines du droit de l’antitrust avec le Sherman Act. L’Union a toujours été plus réticente dans ce domaine mais ce pourrait être opportun que de faire évoluer ce paradigme et d’endosser une géopolitique de la politique de concurrence. La Commissaire Vestager avait indiqué avant la fin de son mandat que cela pourrait être une option 6. Les entreprises américaines exercent aujourd’hui une emprise stratégique dans l’intelligence artificielle ou le cloud computing, ce qui peut créer non seulement des vulnérabilités stratégiques mais aussi des positions dominantes dangereuses pour l’économie numérique européenne contre lesquelles il faut pouvoir se prémunir.
Enfin, l’Europe doit être en mesure de répondre aux outils puissants utilisés par les États-Unis pour extra-territorialiser leurs restrictions à l’exportation et leurs sanctions, à l’image des mécanismes mis en place par le Bureau of Industry and Security (BIS) et la règle du Foreign Direct Product Rule (FDPR). Ces instruments permettent à Washington d’imposer des restrictions à des entreprises étrangères sous prétexte qu’elles utilisent des technologies américaines. C’est le cas par exemple de l’entreprise néerlandaise ASML, leader mondial des machines de lithographie pour semi-conducteurs, régulièrement sous la menace américaine si elle n’interrompt pas ses fournitures de matériels à la Chine. Ces menaces étaient d’abord limitées à quelques produits permettant de produire les semi-conducteurs les plus avancés, mais la liste tend à s’étendre à mesure que le conflit sino-américain s’étend. Ce point est devenu central dans la réponse à l’extraterritorialité des contrôles exports américains. La Commission s’y prépare enfin 7 en insistant sur la coordination des contrôles exports alors qu’ils relèvent en principe uniquement des États membres. Et elle pourrait être amenée à faire usage d’instruments tels que le règlement de blocage ou le mécanisme anti-coercition, dont il faudrait s’assurer qu’il puisse être utilisé pour contrer les restrictions imposées via les contrôles à l’exportation.
Reprendre la main : pour un art du deal européen
Le « protectionnisme de dissuasion », même musclé, ne suffira pas à déclencher une contre-offensive durable contre les initiatives trumpistes.
L’Europe doit aussi reprendre le contrôle du débat mondial. Sa réponse pourrait se bâtir en trois temps : d’abord, un nouveau cadre macroéconomique européen pour rendre possible la mise en œuvre du programme de compétitivité ; ensuite, un pacte avec les pays émergents pour saisir les failles de l’unilatéralisme trumpiste ; enfin, le travail à un nouvel accord du Plaza, avec la Chine et les États-Unis, pour répondre aux déséquilibres globaux en évitant une guerre commerciale.
Pour une grande modernisation du cadre macroéconomique européen
La mise en œuvre simultanée des investissements nécessaires aux dépenses militaires, à l’innovation et à la transition énergétique — dont on ne se lasse pas de rappeler qu’elles sont également au service de notre autonomie stratégique en réduisant notre dépendance aux importations d’énergies fossiles — ne peut se faire à cadre macroéconomique constant. En parallèle des mesures visant à stimuler la productivité en approfondissant le marché intérieur, une vraie réforme des règles budgétaires — plus ambitieuse que la réforme du Pacte de Stabilité et de Croissance d’avril 2024 — est indispensable. Notons que les élections législatives allemandes représentent un tournant décisif, car elles ouvrent la perspective d’une réforme des règles constitutionnelles outre-Rhin. Cela pourrait favoriser une politique budgétaire plus expansionniste au niveau national et ainsi influencer le rapport de pouvoir entre les « frugaux » et les autres au Conseil concernant l’assouplissement des règles budgétaires. Au niveau de l’Union, le financement de la défense européenne, a minima, nécessitera inévitablement la mise en place d’un nouvel emprunt commun et d’une politique d’achats centralisée, avec une préférence claire pour les industries européennes. Dans ce contexte, il est impératif que l’Union ne réduise pas son investissement public et qu’elle prolonge également NextGenerationEU, tout en élargissant son budget à l’horizon 2027.
L’Europe doit cesser d’être à la remorque des initiatives américaines, et reprendre le contrôle du débat mondial.David Amiel et Shahin Vallée
Ces capacités d’emprunt devront être gagées sur l’affectation de nouvelles ressources propres. En matière de fiscalité, l’Europe ne peut plus attendre un consensus mondial qui ne viendra pas avec le tournant de la politique américaine. Elle devra non seulement préserver et approfondir les mesures visant à lutter contre l’optimisation fiscale des multinationales, malgré l’éloignement définitif des perspectives de ratification par le Congrès américain de l’accord trouvé au niveau de l’OCDE mais aussi s’engager davantage concernant l’évasion fiscale des particuliers, l’arrivée au pouvoir de Donald Trump rendant plus pessimiste encore sur des progrès au niveau du G20. Un impôt européen concernant les particuliers les plus fortunés serait une première étape utile, accompagné de la mise en place d’une exit tax, coordonnée sur le plan européen pour éviter les travers des initiatives nationales, afin d’éviter que les grandes fortunes ne déplacent leurs actifs dans des juridictions plus clémentes au moment de quitter un pays.
La digue que constitue le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) est fragilisée par les Etats Unis (en réalité sous Biden déjà) et doit être urgemment consolidée et renforcée. À travers des dispositifs tels que l’IRA et le CBAM européen, une même idée s’imposait, celle d’opérer une convergence entre impératifs économiques, énergétiques, stratégiques et environnementaux : si les États-Unis renoncent à leurs engagements climatiques et abandonnent toute ambition de transition énergétique, ils affaibliront leur propre politique environnementale et endommageront activement les efforts européens. La pression exercée par Washington contre le CBAM européen constitue une menace existentielle pour toute la politique industrielle et climatique de l’Union puisqu’en l’absence d’un tel mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, le marché européen des droits à polluer (ETS) deviendrait insoutenable. Or pour une Europe qui a fait du prix du carbone le pivot central de sa stratégie de transition, une telle remise en cause représenterait un recul stratégique considérable. Il est urgent de renforcer le CBAM à la fois en étendant le périmètre des biens concernés, notamment aux produits finis, en simplifiant sa méthodologie et sa mise en œuvre, et en se dotant d’un mécanisme de subvention aux exportations « décarbonées ». En effet, le CBAM renchérit le prix des biens importé « carbonés », assurant une égalité de traitement avec la production européenne, mais n’abaisse pas le coût des biens « décarbonés » exportés : cette vulnérabilité peut devenir encore plus douloureuse dans le monde qui se dessine où les États-Unis sortiraient de l’accord de Paris et où toute perspective de généralisation de ce type de dispositifs s’éloignerait. Un renforcement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières servira également à dégager des ressources pour des investissements communs.
Pour une alliance de revers entre l’Europe et les émergents
L’unilatéralisme de Donald Trump, symbolisé par la mise en sommeil de l’aide américaine (USAID), offre une opportunité dont les Européens peuvent se saisir rapidement pour forger une nouvelle alliance avec les pays en développement. Il était dans l’intérêt général de la planète de permettre à ceux-ci d’avoir les moyens d’investir, notamment dans la transition énergétique, et c’était l’un des enjeux essentiels du sommet de Paris en 2023. Il devient désormais dans l’intérêt vital des Européens de se saisir de l’interrègne américain pour défendre leurs intérêts stratégiques de sécurisation d’approvisionnement en matériaux critiques, de sauvegarde des accords de Paris, de coopération en matière de sécurité et de migrations… Pour 50 milliards de dollars par an — le budget de l’USAID — l’Union aurait l’opportunité de prendre une position déterminante dans les économies en développement et un nouveau rôle stratégique majeur au côté des grandes économies émergentes.
Les effets les plus probables d’une hausse des droits de douane seraient une plus forte inflation aux États Unis, une appréciation du dollar et un ralentissement mondial qui neutraliseraient rapidement les bénéfices attendus.David Amiel et Shahin Vallée
À court terme, les Européens pourraient répondre aux mesures prises par Donald Trump pour renforcer leurs propres dispositifs, en relançant l’idée de « Routes de la soie » européennes. Sur le plan institutionnel, il devient nécessaire d’engager l’Europe dans une réforme de la gouvernance des institutions financières internationales, en accordant une place accrue aux grandes économies émergentes et d’assumer tous les risques de tensions fortes avec Washington que ceci provoquerait. Enfin, une restructuration de la dette des pays en développement semble inévitable, un nouveau « plan Baker » mais qui devrait cette fois inclure la Chine, dont le rôle est devenu absolument central dans de très nombreux cas.
Les fragilités de l’Administration Trump doivent ainsi être systématiquement exploitées. Dans un tout autre domaine, l’Europe pourrait contribuer à organiser une « fuite à l’envers des cerveaux » présents aux États-Unis, ciblant les chercheurs, les innovateurs, qu’ils soient d’ailleurs de nationalité américaine ou européenne, en leur proposant des avantages matériels, professionnels et une procédure accélérée pour une venue sur le continent.
Vers un nouveau « Plaza »
Au cœur de l’obsession trumpiste figurent les déficits commerciaux chroniques des États-Unis.
Il est vrai les excédents massifs accumulés en Asie et dans certains pays européens, particulièrement l’Allemagne, ont déstabilisé l’économie mondiale ces dernières décennies, en pesant sur la demande lors des phases de ralentissement économique et en fragilisant des filières industrielles clefs tout au long du cycle, y compris en phase « haute » avec l’empilement de « surcapacités », comme on l’observe actuellement en Chine. Il est d’ailleurs notable que depuis la crise financière mondiale qui avait fait de ce sujet un élément clé des discussions au G20, il n’y ait eu aucun progrès notable.
À l’heure actuelle, chaque grand bloc économique adopte précisément la stratégie inverse de celle nécessaire à un rééquilibrage global : l’Europe n’investit pas assez, les États-Unis ne consolident pas assez et la Chine ne consomme pas assez.David Amiel et Shahin Vallée
Mais il est faux de croire qu’on y répondrait par une augmentation généralisée des tarifs douaniers. Les effets les plus probables d’une hausse des droits de douane seraient une plus forte inflation aux États Unis, une appréciation du dollar et un ralentissement mondial qui neutraliseraient rapidement les bénéfices attendus de ces mesures protectionniste sur la demande, tout en ayant un effet délétère sur l’offre, en déstabilisant profondément les chaînes de valeur. À cela s’ajoute naturellement que l’effet d’incertitude liée à des décisions erratiques en matière commerciale risque de gripper nombre d’investissements 8.
Ces analyses semblent infuser y compris au sein des proches de Donald Trump. Le duo composé de Peter Navarro et Robert Lighthizer, respectivement conseiller du Président et United States Trade Representative sous Trump I, était très animé par la volonté d’utiliser les tarifs douaniers pour rééquilibrer le déficit courant américain. Un nouveau duo, composé de Stephen Miran, Président du Council of Economic Advisors 9 et Scott Bessent, Secrétaire du Trésor 10, a en revanche produit des analyses convergeant autour de la sur-évaluation structurelle du dollar comme cause centrale du déficit courant américain. Elles ne sont pas exemptes de tension, puisqu’elles défendent à la fois le rôle du dollar comme monnaie de réserve (ce qui a un effet haussier sur le change) et la nécessité impérative de réduire les déficits courants (ce qui plaiderait pour une dépréciation). À cette tension économique s’ajoute une tension politique entre la multiplication des annonces de droits de douane (ce qui aura un effet haussier sur le change) et la pression mise sur la Réserve fédérale pour obtenir des taux d’intérêt bas, favorables aux marchés financiers (ce qui aurait un effet baissier sur le change).
L’Europe, on l’a vu, doit soutenir bien davantage sa demande intérieure. La Chine, quant à elle, doit rééquilibrer son économie en favorisant la consommation plutôt que l’investissement excessif. Pour atteindre cet objectif, une relance budgétaire d’ampleur est nécessaire, accompagnée d’un ajustement important du taux de change : une appréciation significative du renminbi (RMB) permettrait de rééquilibrer l’économie chinoise, mais risquerait d’avoir un impact déflationniste sur la Chine et de ralentir la croissance mondiale si elle n’était pas accompagnée de mesures de soutien intérieur suffisantes. Les États-Unis ne peuvent pas se contenter de dénoncer les déséquilibres extérieurs sans admettre leur propre responsabilité dans cette situation, car leur consommation intérieure excessive et leur politique budgétaire expansionniste sont des facteurs majeurs à l’origine des déséquilibres globaux. Pour y remédier, Washington doit s’engager dans une consolidation budgétaire forte et crédible. Toutefois, une telle réduction du déficit ne peut être mise en œuvre sans risque récessif pour l’économie mondiale, sauf si l’Europe et la Chine prennent le relais en stimulant leur propre demande. À l’heure actuelle, chaque grand bloc économique adopte donc précisément la stratégie inverse de celle nécessaire à un rééquilibrage global : l’Europe n’investit pas assez, les États-Unis ne consolident pas assez et la Chine ne consomme pas assez.
Un rééquilibrage durable implique notamment un accord comparable à l’Accord du Plaza (1985). Il devrait mener à une appréciation du yuan, à une dépréciation du dollar, et à une relance de la demande intérieure européenne — via une hausse de l’investissement public appuyée par de nouvelles ressources propres —, en contrepartie d’une trêve dans la guerre commerciale. L’Europe, si elle parvient à retrouver une position de force, devrait prendre l’initiative de ce sommet multilatéral sur la coordination des changes et des politiques macroéconomiques 11. Cette approche nécessite une vraie révolution pour les Européens, puisque la politique de change y demeure un sujet tabou et que l’Union s’est historiquement montrée réticente à prendre des engagements multilatéraux en matière budgétaire, y compris lors de la crise financière de 2008, malgré d’importantes pressions américaines.
Conclusion : une alternative européenne à la guerre commerciale
La tétanie des Européens devant l’offensive trumpiste reflète un désarroi idéologique plus profond : celui d’une grande partie des élites occidentales face à la désagrégation des illusions de Pax Americana, du « doux commerce » et du modèle néo-libéral. La crise du Covid-19 et la montée des tensions géopolitiques ont révélé les vulnérabilités générées par une intégration des chaînes de valeur mondiales et remis au premier plan les enjeux de souveraineté. La montée du vote pour les partis populistes a rappelé à ceux qui étaient tentés de le refouler les fractures sociales et territoriales creusées par la nouvelle économie mondialisée. Les déséquilibres persistants et massifs des comptes courants apparaissent progressivement comme insoutenables. La force de séduction du nationalisme économique de Donald Trump vient de sa capacité à donner le sentiment, erroné, de répondre à ces failles réelles.
Il est à ce titre révélateur que Joe Biden n’ait pas choisi de revenir à la ligne économique de Barack Obama. Sa politique industrielle s’est traduite par une utilisation massive des subventions directes et des crédits d’impôt, promulgués par le biais de l’Inflation Reduction Act (IRA), du CHIPS Act, et du Research and Development, Competition, and Innovation Act — tous tournés sur des industries jugées particulièrement critiques ou stratégiques, principalement les semi-conducteurs et les technologies vertes. Sa politique commerciale s’est traduite notamment dans la doctrine dite du « small yard, high fences », qui relevait d’un protectionnisme ciblé et au service de la transition énergétique.
La tétanie des Européens devant l’offensive trumpiste reflète un désarroi idéologique plus profond : celui d’une grande partie des élites occidentales face à la désagrégation des illusions de Pax Americana, du « doux commerce » et du modèle néo-libéral. David Amiel et Shahin Vallée
Les Européens ne peuvent non plus prêcher un retour au statu quo ante. Ils doivent solidement défendre leurs intérêts, accélérer leur politique d’innovation et de derisking et, sur la base de rapports de force et de deals successifs, proposer une alternative aussi ambitieuse que celle de Donald Trump pour « reprendre le contrôle » de la mondialisation, en s’attaquant à la concurrence fiscale, aux déséquilibres macroéconomiques, au financement de la transition énergétique par un nouvel élan de coopération avec les pays du Sud. La reprise en main de ces flux financiers est, à long terme, la seule manière de répondre à la vague nationaliste et d’éviter une guerre commerciale destructrice et vaine.
Si cette perspective de long terme ne suffira sans doute pas à convaincre nombre d’Européens d’opérer une révolution culturelle, ils pourraient se contenter de considérer leurs intérêts de court terme. Il serait illusoire de croire que l’on pourrait, dans la discussion transatlantique, séparer les enjeux stratégiques, liés à l’architecture de sécurité en Europe, des questions économiques, tout comme nous ne pourrons traiter de celles-ci en négociant de manière distincte les volets fiscaux, commerciaux, macroéconomiques, réglementaires, etc. Si l’organisation politique du continent, ainsi que ses habitudes idéologiques, l’ont habitué à des approches en silos, il serait mortifère de raisonner ainsi face à une Administration Trump qui ne cesse de croiser les dossiers. C’est en définissant le plus rapidement une approche complète que les Européens pourront enclencher un rapport de force plus favorable, évitant de vendre leurs intérêts à la découpe dans les prochains mois, dans un Munich sans cesse recommencé.
Bateaux, motos, bourbon… L’UE réplique aux droits de douane de Trump en taxant une série de produits américains
La réplique du Vieux Continent ne s’est pas fait attendre. La Commission européenne a annoncé ce mercredi matin qu’elle appliquerait des droits de douane «forts mais proportionnés» sur une série de produits américains à partir du 1er avril, en réponse aux taxes américaines de 25% sur l’acier et l’aluminium. L’UE «regrette profondément» les mesures décidées par le président Donald Trump, a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans un communiqué. «Les droits de douane sont des taxes. Elles sont mauvaises pour les affaires et encore pires pour les consommateurs. (…) Des emplois sont en jeu. Les prix vont augmenter. En Europe et aux États-Unis.»
La Commission européenne estime que les mesures américaines affecteront 28 milliards de dollars de marchandises, soit 26 milliards d’euros. Elle a annoncé que la réplique de l’UE toucherait le même montant de marchandises américaines. Les droits de douane de 25% sur l’acier et l’aluminium voulus par le nouveau locataire de la Maison Blanche sont devenus effectifs mercredi à 00h01 (04h01 GMT), marquant une nouvelle étape dans la guerre commerciale entre les États-Unis et ses principaux partenaires commerciaux.
Le Canada, la Chine, l’Union européenne, le Japon ou encore l’Australie sont concernés, alors que le but affiché de Donald Trump est de protéger l’industrie sidérurgique américaine, qui voit sa production baisser d’année en année, confrontée à une concurrence de plus en plus vigoureuse, provenant notamment d’Asie. Le président américain avait déjà taxé les importations d’acier et d’aluminium durant son premier mandat (2017-2021) mais cette nouvelle taxe se veut «sans exception et sans exemption», a-t-il assuré lors de leur annonce, début février.
À lire aussi : Les choix économiques de Donald Trump déstabilisent Wall Street
La réplique européenne s’effectuera en deux temps. Au 1er avril, les contre-mesures de l’UE mises en place en 2018 et 2020 en réponse aux droits de douane américains du premier mandat de Donald Trump seront automatiquement rétablies, leur suspension arrivant à expiration au 31 mars. «Pour la première fois, ces mesures de rééquilibrage seront mises en œuvre dans leur intégralité. Des droits de douane seront appliqués sur des produits allant des bateaux au bourbon en passant par les motos», a expliqué la Commission européenne.
Mais les nouveaux droits de douane américains entrés en vigueur mercredi vont beaucoup plus loin que ceux du premier mandat de Donald Trump. Par conséquent, la Commission européenne a lancé ce mercredi 12 mars une procédure pour imposer des contre-mesures supplémentaires à l’encontre des États-Unis afin d’arriver au même impact que les mesures américaines. La première étape de cette procédure est une phase de «consultation de deux semaines avec les parties prenantes de l’UE» afin de garantir que «les bons produits» seront visés et «assurer une réponse efficace (…) réduisant au minimum les perturbations pour les entreprises et consommateurs européens». Ces mesures additionnelles devraient entrer en vigueur mi-avril.
A lire aussi : Sous l’ère Trump – Appels à l’Europe – Quelles conditions politiques pour être au RDV ?
4. Les US vs. le reste du monde
Alternative : Un comité pour sauver le reste du monde ?
Face au chaos semé par Trump 2.0, le reste du monde ne peut plus attendre un leadership américain défaillant. La réponse ? Unir les forces, réinventer le multilatéralisme et réorganiser les instances internationales sans les États-Unis. Le G20, privé de Washington cette année, pourrait devenir ce « Comité pour sauver le reste du monde ». Ce contrepoids apparaît comme nécessaire face à l’unilatéralisme américain, pour empêcher que l’agenda de Trump ne devienne la norme mondiale. La question n’est plus de savoir si le monde doit réagir, mais qui prendra les devants.
- Répliquer aux tarifs douaniers : Bien que des représailles soient inévitables, des alternatives plus intelligentes existent, comme subventionner les industries touchées et réduire les droits de douane sur les importations non américaines.
- Renforcer les accords commerciaux : L’élargissement des accords comme le Partenariat régional économique global (RCEP) ou la relance du pacte d’investissement UE-Chine peuvent contrebalancer les perturbations causées par les États-Unis.
- Préserver le multilatéralisme : Malgré l’affaiblissement de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), elle reste le meilleur outil pour contester les tarifs de Trump.
L’histoire montre que l’absence de leadership mondial peut mener au chaos, comme dans les années 1930. Aujourd’hui, le principal architecte du système international, les États-Unis, s’en désolidarise.
Un nouveau leadership est donc nécessaire.
L’abandon du G20 par les États-Unis offre une opportunité unique au reste du monde pour organiser sa réponse. La question est : qui relèvera le défi ?
Sources :
- Comment l’Europe peut faire plier Trump: notes stratégiques pour organiser la résistance | Le Grand Continent
- Les États-Unis sont-ils devenus les ennemis de l’Europe ? 11 perspectives transatlantiques | Le Grand Continent
- Tariff whiplash | What we are reading | Hinrich Foundation
- America First Investment Policy – The White House
- Bateaux, motos, bourbon… L’UE réplique aux droits de douane de Trump en taxant une série de produits américains
- Responding to Trump 2.0: A Committee to Save the Rest of the World | Article | Hinrich Foundation
- Press corner | European Commission